Les archives constituent un pilier fondamental de toute démocratie. Elles permettent à chaque citoyen.ne d’accéder à l’information, de comprendre comment les décisions sont prises et, surtout, d’exercer un contrôle a posteriori sur l’action publique.
Sans archives, pas de transparence.
Sans transparence, pas de démocratie.
Pourtant, lorsqu’il s’agit des archives politiques, leur statut, leur conservation et leur avenir restent largement malmenés.
Archives publiques, archives privées : quelle différence ?
Pour mieux comprendre les archives, on distingue généralement les archives publiques, produites par les administrations et institutions publiques et soumises à des règles strictes et les archives privées, produites par des organisations, mouvements ou personnalités.
Mais cette distinction se brouille lorsque l’on aborde les archives politiques, en particulier celles des cabinets ministériels. En Belgique, plusieurs textes régionaux et communautaires considèrent théoriquement ces archives comme publiques. Pourtant, aucun arrêté d’application n’a jamais été adopté. Résultat : elles sont de facto traitées comme des archives privées, sans obligation de conservation, de tri ou de versement.
Conséquence directe : leur sort dépend entièrement du bon vouloir des ministres ou de leur équipe. Selon une étude d’Aksoni, seuls 42 % des ministres francophones ayant exercé entre 2003 et 2024 ont versé leurs archives.
Plus d’une archive ministérielle sur deux risque donc de disparaître, emportant avec elle des pans entiers de l’histoire de nos décisions publiques.
De quoi parle-t-on quand on parle d’archives politiques ?
Les archives politiques ne se résument pas aux dossiers produits par les ministres. Elles comprennent aussi les archives des partis ; celles des mouvements citoyens, syndicaux et associatifs ; les archives personnelles de militant.e.s, conseiller.ères et collaborateur.ices.
Elles sont essentielles pour comprendre l’évolution des idées, les débats publics, les choix collectifs et les mécanismes démocratiques.
Sans elles, notre compréhension de la vie politique belge devient lacunaire, partiale et fragile.
En raison de leur statut hybride, elles sont conservées soit dans des centres d’archives publics, soit dans des centres d’archives privés « dits politiques », reconnus et encadrés par décret en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ces centres d’archives privées jouent un rôle patrimonial essentiel, sans lequel une grande partie de la mémoire politique francophone disparaîtrait tout simplement. Parmi eux, quatre sont historiquement liée à une idéologique politique : le CPCP, l’IEV, Etopia et le Centre Jean Gol.
Ils accueillent, trient, préservent et rendent accessibles des fonds précieux, tout en étant indépendants des partis, constitués en asbl, évalués par des commissions d’avis, soumis à des exigences décrétales strictes en matière de gestion, de transparence et d’accessibilité.
Des centres d’archives politiques désormais menacés
Depuis peu, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles envisage de retirer la reconnaissance et le financement de ces centres d’archives liés historiquement à des traditions politiques. L’argument avancé : éviter un financement indirect des partis.
Mais cette vision méconnaît totalement le rôle réel de ces institutions, dont les missions sont culturelles, patrimoniales et scientifiques, et non partisanes.
Elle oublie également que faute d’obligation légale de verser les archives politiques, la disparition de ces centres laisserait un vide irréparable : une grande partie de la mémoire politique francophone ne serait conservée nulle part.
Conserver les archives : un enjeu de bien commun
La Déclaration de politique communautaire de 2024 rappelait pourtant que :
« La conservation des archives est un enjeu fondamental. Elle répond à des objectifs de transparence et de transmission des savoirs, permettant un regard critique sur le passé et une compréhension du présent. »
Les archives politiques sont un bien commun. Elles appartiennent symboliquement à l’ensemble de la société, car elles documentent notre histoire collective.
Les protéger, c’est préserver la possibilité de comprendre le passé, analyser le présent, éclairer l’avenir.
Dans plusieurs pays — notamment en Allemagne — la sauvegarde des mémoires politiques est assumée par l’État pour garantir le pluralisme, la transparence et l’accès équitable aux sources.
Si les pouvoirs publics se désengagent aujourd’hui, les conséquences seront immédiates la disparition de pans entiers de notre mémoire politique, un déséquilibre croissant avec la Flandre, où ces centres sont correctement financés, un accès fragilisé pour les chercheur.euses, journalistes, étudiant.e.s et citoyen.ne.s.
Les archives : un rempart contre la montée de l’autoritarisme
L’histoire récente nous l’a rappelé, en Europe comme ailleurs : la fragilisation des archives et l’opacité des décisions publiques vont souvent de pair avec les dérives autoritaires.
Les archives permettent de retracer les responsabilités, empêchent la réécriture du passé, protègent contre les abus de pouvoir et constituent une base objective pour le débat démocratique.
Détruire ou laisser disparaître les archives politiques, c’est affaiblir l’un des premiers garde-fous de l’État de droit.
Préserver les archives politiques n’est pas un luxe. C’est un investissement démocratique indispensable.
Focus : Les centres d’archives politiques en Fédération Wallonie-Bruxelles
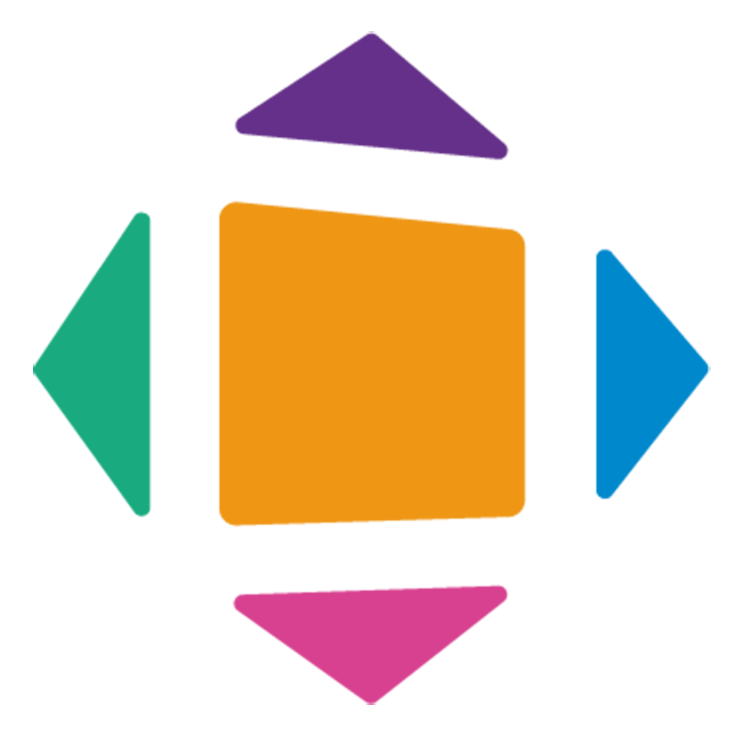
Centre d’archives de Citoyenneté et Participation (CPCP asbl)
Le centre d’archives de Citoyenneté et Participation, reconnu et subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, est en charge de la conservation des archives de la mouvance sociale-chrétienne et démocrate-humaniste et, à ce titre, des documents produits par le mouvement politique Les Engagés. Le centre d’archives préserve notamment des dizaines de fonds papiers et numériques de personnalités politiques, de cabinets ministériels ou encore d’organisations satellites, mais également de nombreuses collections.
Il garantit la préservation de fonds représentatifs des luttes sociales, politiques, économiques et culturelles et assure la mise à disposition et la diffusion de ces ressources auprès de tous les publics et des générations futures dans le respect des règles de confidentialité.
IEV (Institut Émile Vandervelde)
Le Service Bibliothèque et Archives de l’Institut Émile Vandervelde, fondé en 1947 dans le prolongement des activités de l’Institut national d’Histoire sociale créé dans l’entre-deux-guerres, a pour mission de collecter, préserver et valoriser la mémoire du mouvement socialiste en Belgique dans toute sa diversité, tant au niveau du parti que des organisations qui lui sont affiliées, ainsi qu’à travers les archives de ses militant·es et de ses élu·es. Depuis l’absorption des archives d’Alphas en 2025, ses collections — couvrant une période allant du XIXᵉ au XXIᵉ siècle — se sont encore enrichies et comptent aujourd’hui près de 2 km/l d’archives, une bibliothèque de plus de 60 000 items, plusieurs milliers d’affiches et de documents iconographiques, ainsi qu’un ensemble remarquable d’œuvres d’art. Les documents sont accessibles gratuitement, sur rendez-vous, tous les jours de la semaine.


Etopia
Crée en 2003, le centre d’archives a pour objectifs d’accueillir les archives liées à l’écologie politique et la mouvance environnementale, d’assurer le traitement archivistique de ces fonds et de les valoriser auprès d’un large public. Son patrimoine relativement jeune est à la fois de nature politique, associative et militante. Il rassemble les archives du parti Ecolo créé en 1980, celles du parti vert européen, de même que les archives de la plupart des associations environnementales et écologistes ainsi que de personnes engagées dès les années 60 dans la préservation de la nature ou dont les revendications sont à mettre en lien avec les fondements de l’écologie politique.
Centre Jean Gol
La « section archives » du Centre Jean Gol a pour but la conservation et la mise en valeur du patrimoine historique de la famille libérale belge, spécifiquement francophone. Elle s’intéresse dès lors à tous les documents relatifs à l’histoire du parti libéral depuis sa première organisation officielle, en 1846 ; comme à tous ceux, mêmes antérieurs à cette date, susceptibles d’apporter un éclairage quant à l’histoire politique de la Belgique contemporaine.

Ces quatre centres assurent ensemble la pluralité des mémoires politiques en Fédération Wallonie-Bruxelles — un socle essentiel pour comprendre l’évolution démocratique du pays.
