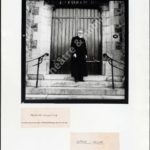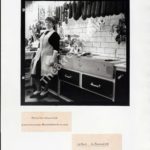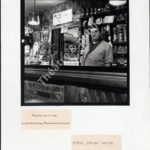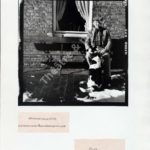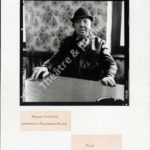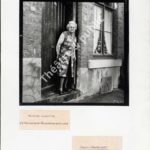Aksoni a invité ses membres à partager leurs « archives coups de cœur » afin de montrer, très concrètement, ce que les archives disent de nos organisations, de nos pratiques et de nos territoires. Car au-delà de la préservation du passé, les archives permettent aussi de documenter, comprendre et piloter le présent. Elles sont des outils de travail, d’analyse, de transparence, de création.
Après un premier focus sur les archives publiques, nous nous tournons ici vers les archives privées : celles que produisent quotidiennement associations, entreprises, collectifs ou toute personne. Souvent discrètes, parfois sous-estimées, ces archives constituent pourtant la matière première de nombreuses décisions, recherches et projets.
Pour l’occasion, deux acteurs ont accepté d’ouvrir leurs boîtes, leurs dossiers, leurs images : le CArCoB, centre d’archives privées reconnu en FWB, spécialisé dans le mouvement ouvrier et Théâtre & Publics, association active depuis plus de quarante ans dans les arts de la scène.
Deux institutions, deux environnements, mais une même conviction : les archives ne servent pas seulement à raconter ce qui a été — elles permettent aussi de comprendre ce qui est et d’imaginer ce qui vient.
1. Le témoignage de François Belot, archiviste au CArCoB
Au cœur des collections du CArCoB, centre d’archives privées reconnu par la FWB, François Belot, archiviste, a souhaité nous faire découvrir son document coup de cœur. Il s’agit d’une photographie du 21 février 1959 qui témoigne d’un moment de tension et de solidarité : la grève au puits du Crachet, dans le Borinage. Le cliché est signé d’un photographe du Drapeau Rouge, l’organe de presse du Parti Communiste.
François Belot, archiviste, explique pourquoi cette image l’a profondément marqué :
« On y voit un groupe de mineurs qui tiennent le piquet de grève devant le Puits Saint-Arthur à Morlanwelz. C’est l’hiver : ils sont emmitouflés, la journée semble froide. Une femme s’approche pour leur servir une jatte de café. C’est un geste simple, mais chargé de solidarité et de courage. Ces hommes – collègues, voisins, amis, de parfaits “inconnus de l’Histoire” – se retrouvent devant leur usine, unis pour refuser les fermetures et défendre leur avenir. Les femmes y jouent un rôle essentiel : elles manifestent, brandissent des pancartes, tiennent des barrages ou aident sur les piquets.
Mon grand-père paternel, mineur comme l’avait été son père avant lui, a sans doute été témoin de ces événements. Aujourd’hui, même si les mines ont fermé, la lutte contre le chomage, la précarité et l’exploitation continuent autrement. Ces combats restent une source de fierté et d’inspiration. »
Une archive qui raconte une région en lutte
La photographie plonge au cœur d’un moment clé : le 13 février 1959, une grève débute au puits du Crachet après l’annonce de la fermeture de huit sièges charbonniers dans le Borinage, condamnant 7 000 mineurs au chômage. Très vite, le mouvement s’étend : métallurgie, transports, services publics… la mobilisation gagne Charleroi, Liège, le Centre, et même les mineurs du Limbourg se disent prêts à suivre. C’est dans cette vague de colère sociale que le photographe immortalise la scène choisie par le CArCoB.
Ce document est l’un des nombreux trésors que conserve le CArCoB. Et derrière cette photographie, c’est tout un univers d’archives qui reste à explorer : des fonds parfois peu connus, parfois en attente de traitement ou de valorisation, mais qui constituent autant de fragments de l’histoire francophone belge.
Le CArCoB : un centre qui fait vivre la mémoire du mouvement ouvrier
C’est précisément la mission du CArCoB : collecter, préserver et rendre accessibles ces archives qui racontent l’histoire du mouvement ouvrier en Belgique, en particulier sa composante communiste francophone et les organisations qui lui sont liées. Créé dans les années 1970 et reconnu par la FWB comme centre d’archives privées en 1996, le centre est aujourd’hui animé par une équipe de deux personnes, dont l’expertise permet de donner une seconde vie à des milliers de documents : photographies, affiches, périodiques, films, publications…
« Le défi, au quotidien ? Faire tourner le centre à deux », résume l’équipe. Entre inventaires, accueil des chercheurs, numérisation, valorisation et sensibilisation des détenteurs d’archives privées, les tâches ne manquent pas. Et un enjeu reste crucial : faire connaître le centre afin de stimuler de nouveaux dépôts. Car derrière chaque boîte, chaque dossier, il y a une histoire qui attend d’être transmise.
Parmi les projets en cours ou à venir : une contribution à une exposition du musée de Mons consacrée aux artistes communistes, la poursuite de la numérisation de documents sensibles, mais aussi le développement des collections et l’extension du réseau de chercheurs qui s’y intéressent.
Malgré sa petite taille, le centre multiplie les initiatives : inventaires, publications, conférences, expositions… et voit ses mètres linéaires d’archives conservées augmenter chaque année. Ces initiatives ont permis au centre de développer son réseau, de nombreux chercheurs contactent le CARCOB depuis l’étranger pour consulter les fonds. Ainsi, malgré sa modeste taille, le centre a pu se frayer une place dans le monde des archives, particulièrement celles qui concernent le mouvement ouvrier (et même le mouvement anticolonial) en Belgique.
« Ce que je préfère dans ce métier ? Le contact permanent avec l’Histoire… et avec celles et ceux qui la font vivre », nous confie l’archiviste.
2. Le témoignage de Théâtre & Publics – Quand les archives révèlent l’envers du plateau
Avant de plonger dans leur archive coup de cœur, il faut comprendre ce qu’est Théâtre & Publics asbl, association active depuis plus de quarante ans au cœur du secteur des arts de la scène. Créée le 28 juin 1983 et composée aujourd’hui de 7 personnes, l’association mène un travail essentiel : accompagner les artistes, soutenir la formation, favoriser l’accès aux études artistiques, documenter les pratiques théâtrales et préserver leur mémoire.
Les archives : les traces du travail invisible
Depuis 2009, Théâtre & Publics développe un service d’archives théâtrales qui ne cesse de s’enrichir : Groupov, Max Parfondry, René Hainaux, Théâtre de l’Ancre et bien d’autres. Tous ces fonds documentent non seulement les spectacles, mais aussi leurs processus de création.
L’équipe le résume ainsi : « Le théâtre est un art de l’éphémère. Les archives en sont la trace — affiches, captations, programmes — mais aussi le récit du chemin parcouru pour créer un spectacle. On y trouve les hésitations, les idées griffonnées, les demandes de subsides, les rapports… Tout ce qui montre la ténacité nécessaire pour faire naître une œuvre. » Ces documents permettent de comprendre non seulement ce qui a été, mais aussi comment, avec qui, dans quelles conditions, et à partir de quels questionnements.
Préserver et valoriser ces fonds reste un défi constant : « Cela exige du personnel qualifié et des moyens. Cette campagne est l’occasion de montrer l’un de nos trésors. »
Pour évoquer le rôle des archives, l’équipe cite volontiers Brecht : une simple photo d’usine Krupp ne raconte rien des rapports sociaux qu’elle abrite.
« De la même manière, un document isolé ne suffit pas. Mais la lecture, dans la longueur des pages et du temps, de ces rapports, de ces correspondances, nous renvoie aux luttes présentes, pour l’accessibilité de la culture et pour la défense de toutes les cultures, pour la défense d’une pédagogie exigeante et toujours en recherche, soutenue mais non soumise par le pouvoir. ».
L’équipe nous mentionne également que « Marc Trivier dit de la photographie « La photographie ne dit qu’une chose : “C’était.” On ne fixe que ce qui a été. S’il y a une tragédie, elle est là. », les archives portent un « c’était » mais, ne formant pas œuvre en elles-mêmes, elles nous tendent des perches de réactivation, des éclairages actifs sur les luttes et questionnements que nous ressentons le besoin d’activer. »
L’archive coup de cœur : des portraits de village avant la création
En préparant une numérisation, l’équipe tombe sur une farde de grandes feuilles A3 retraçant une expérience pédagogique menée en 1982 dans un village de la région liégeoise. À l’intérieur : des portraits noirs et blancs, tirages originaux en 6×6, représentant les habitant·es du village. Ces images avaient servi de matériau aux comédiens pour approcher le réel des publics devant lesquels ils allaient jouer. Lors des représentations, elles étaient exposées aux côtés de photographies personnelles prêtées par les habitants, capturant un moment charnière dans la transformation de la campagne liégeoise.
La surprise apparaît ensuite : « Nous découvrons que ces photos sont de Marc Trivier, alors étudiant à La Cambre. On reconnaît déjà ce soin du cadre qui marquera plus tard ses portraits de Beckett, Heiner Müller, Genet ou Bacon. »
Ce qui touche l’équipe ne tient pas qu’aux images : « Il y a d’abord ces photographies magnifiques. Mais aussi tout le dossier : les notes manuscrites, les pages écrites jour après jour, tout ce qui raconte le temps de la recherche et celui de la transmission. C’est un précieux témoignage du travail invisible qui mène à la création. »
Conclusion
Ces deux témoignages le montrent : les archives privées ne sont pas de simples documents dormant sur des étagères. Elles captent des gestes de solidarité, des luttes, des territoires en mutation, mais aussi le travail invisible qui précède toute création artistique. Elles racontent autant les grands mouvements sociaux que les démarches patientes et sensibles de celles et ceux qui font vivre la culture.
Qu’il s’agisse d’une photographie de grève ou d’un dossier pédagogique oublié, chaque archive ouvre une porte sur un passé qui continue d’agir dans le présent. Et si ces fragments d’histoires existent encore aujourd’hui, c’est grâce au travail discret, tenace et indispensable des archivistes, des documentalistes et des médiateurs qui les collectent et les valorisent.
En révélant ces « coups de cœur », Aksoni souhaite rappeler une évidence : préserver les archives privées, c’est préserver notre mémoire collective. Une mémoire diverse, vivante, faite de combats, d’expériences, de territoires et de voix qui méritent d’être entendues — et transmises.
Vous souhaitez lire les deux autres articles « coups de cœur » ? Ils sont disponibles ici : archives publiques et utilisateurs.trices