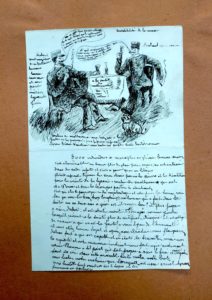Dans le cadre de sa campagne « Archiviste, héros et héroïnes de notre société », Aksoni a souhaité donner la parole à celles et ceux qui fréquentent les salles de lecture, manipulent les documents du passé et redonnent vie à des histoires parfois oubliées.
Chercheurs, étudiants, passionnés, artistes : tous entretiennent un lien intime, presque viscéral, avec les archives.
À travers les voix de Nicolas Verschuren, professeur d’histoire contemporaine à l’Université libre de Bruxelles, Amaury Ketele, jeune diplômé en archivistique, et Pauline Fonsny, monteuse et réalisatrice de films documentaires, se dessine une même passion : comprendre, transmettre et faire entendre les voix du passé.
1. « Merksplas, ou les voix retrouvées » — Témoignage de Pauline Fonsny,
Réalisatrice et chercheuse, Pauline mène depuis plusieurs années un travail de recherche pour un film documentaire consacré à l’histoire de la colonie pénitentiaire de Merksplas, ouverte en 1825.
Située dans la province d’Anvers, en Campine, à la frontière avec les Pays-Bas, cette colonie fut construite sur d’anciennes terres communales « vaines, vagues et incultes ». On y enfermait et mettait au travail des personnes sans logement ni revenus, criminalisées pour vagabondage en vue de les « civiliser ».
Merksplas a officiellement fermé ses portes en 1993, mais ses murs, eux, continuent de raconter.
« Aujourd’hui, dans ce vaste domaine de plusieurs centaines d’hectares, on trouve d’un côté une prison de droit commun et un centre fermé pour personnes dites illégales, et de l’autre un complexe touristique — restaurant, hôtel de luxe, musée — dont certaines fenêtres donnent directement sur les grilles du centre fermé. »
Les archives comme terrain de fouille
Pour retracer la généalogie de cet espace, Pauline s’est plongée dans les Archives générales de l’État, notamment au dépôt d’Anvers.
« J’ai opéré une plongée dans l’immensité des centaines de kilomètres de documents stockés aux Archives générales de l’État, et plus spécifiquement au dépôt d’Anvers où sont conservées la majorité des archives de cette colonie. Attablée dans la salle de lecture durant de nombreuses journées, fascinée par l’histoire qui s’ouvrait sous mes yeux, je me suis noyée dans la masse de dossiers disponibles, ne sachant vite plus ce que je cherchais…
Cependant, ces archives, bien qu’extrêmement intéressantes, me paraissaient dans l’ensemble n’offrir qu’un seul point de vue sur cette histoire : celui des employés de l’administration, des gestionnaires aux décisionnaires — ministres, directeurs, médecins, architectes, gardiens, etc. »
Jusqu’au jour où une découverte bouleverse son approche :
« Je suis tombée sur un petit dossier titré en rouge : “lettres de menace”. Ces lettres, écrites par des hommes enfermés pour vagabondage, donnaient accès à un autre regard, celui des détenus eux-mêmes. »
Parmi elles, une lettre adressée au directeur de la colonie au début du XXᵉ siècle, Louis Stroobant, la marque profondément.
« Ce texte, écrit il y a plus de cent ans, résonne avec les paroles actuelles des personnes enfermées dans le centre fermé de Merksplas. Les mêmes dortoirs, les mêmes murs, les mêmes violences. »
À travers son film, Pauline interroge cette continuité des logiques d’enfermement et d’exclusion.
Ces lettres témoignent de la persistance des structures de domination. En donnant voix à ceux qu’on a réduits au silence, l’archive devient un espace de résistance.
2. « Des archives à la vocation » — Témoignage d’Amaury Ketele
Pour Amaury, l’histoire est avant tout une affaire de curiosité.
« Depuis mes secondaires, j’ai toujours été passionné par l’histoire », confie-t-il.
C’est donc naturellement qu’il entreprend, en 2020, un bachelier en histoire, avant de se spécialiser dans un master en archivistique, obtenu en juin 2025.
La passion pour les archives survient presque par hasard :
« Pour un séminaire d’histoire, j’ai été amené à dépouiller les carnets de prêtres pendant la Première Guerre mondiale. Ces recherches m’ont conduit aux Archives de l’État à Arlon, et cette première expérience a été un véritable choc. »
C’est dans ces salles feutrées qu’il découvre un univers à la fois concret et poétique : la matérialité des documents, les traces humaines derrière chaque dossier, le silence peuplé des voix du passé.
Les archives, fondement de la recherche
En dernière année, Amaury consacre son mémoire à un sujet ambitieux :« Les services de télécommunications et les services postaux au temps de l’État Indépendant du Congo (1886–1908). »
« J’ai consulté pas moins de vingt-trois fonds d’archives répartis dans cinq centres différents. Sans ces sources, mon mémoire n’aurait tout simplement pas pu exister. »
Ces recherches l’amènent notamment aux Archives générales du Royaume II et au Musée de l’Afrique à Tervuren.
« Ces archives montrent à quel point les services de communication étaient un instrument de pouvoir et un symbole de modernité pour Léopold II. »
Parmi ses découvertes, Amaury évoque deux images fortes.
La première : une photographie de la galerie de boîtes postales de Léopoldville (1955) conservée dans la photothèque du Musée de l’Afrique. Elle témoigne de la continuité d’un système mis en place par Léopold II dès la fin du XIXᵉ siècle et devenu moteur économique. En 1955, les locations de boîtes postales rapportaient à elles seules quatre millions de francs par an à la colonie.
La seconde : un cliché daté de 1914 montrant des troupes de la Force publique installant une ligne télégraphique aérienne à Kigoma.
Ce document résume à lui seul les enjeux politiques et militaires de l’époque. Les télécommunications représentaient une véritable innovation, mais leur coût les rendait inaccessibles au particulier. Leur installation, encadrée par l’armée, traduisait la volonté de Léopold II de contrôler l’information.
De la recherche à la transmission
Aujourd’hui, Amaury a franchi une nouvelle étape : il est passé « de l’autre côté », celui de la préservation et de la mise à disposition des fonds.
« L’accès aux archives est pour moi un droit fondamental. La transmission et l’accessibilité de ces documents constituent un acte essentiel pour toute société. »
Pour lui, les archives sont un outil de connaissance, un lien entre générations
3. « Les archives, une promesse de découverte » — Témoignage de Nicolas Verschuren
Pour Nicolas, tout commence il y a près de vingt ans, sur les bancs de l’université :
« C’est au travers de mes études en histoire que j’ai découvert l’univers des archives. Celles-ci ne m’ont plus quitté depuis près de vingt années. La lecture d’un inventaire représente la promesse d’une découverte. Il n’est jamais question de trouver le document qui résoudrait la clé d’un mystère, mais plutôt de découvrir un monde inconnu ou oublié », nous confie Nicolas.
Les archives sont pour lui un terrain d’exploration intellectuelle, mais aussi sensorielle. Une salle de lecture devient un lieu d’épanouissement :
« Je ne me sens jamais aussi épanoui que dans une salle de consultation d’archives. Observer et comprendre les rouages du passé stimule mon imaginaire. »
Au fil des recherches, le hasard réserve parfois des surprises touchantes. Nicolas se souvient d’un moment inattendu :
« En dépouillant les archives de la Jeunesse ouvrière chrétienne des années 1970, j’y ai retrouvé un dessin réalisé par le père de mon collègue de bureau. »
Dans les archives, on croise des anonymes, mais aussi parfois des silhouettes familières. Le passé rejoint le présent, et c’est toute la magie des fonds conservés.
Parmi les documents qui l’ont marqué, Nicolas évoque une lettre bouleversante écrite par un mineur, victime d’un grave accident de travail. Cette correspondance, liée à une demande de réévaluation de l’indemnité et à une tentative de reclassement professionnel, était adressée au directeur de la caisse d’assurance.
« Le papier froissé, l’écriture tremblotante et hésitante, le contraste entre les fautes et les formules de politesse m’ont ébranlé. Cet émoi ne provenait pas des souffrances vécues, mais plutôt de la matérialité soudaine d’un monde et des tensions qui le traversaient et qui échappaient pour partie à mon entendement. Voix du passé, écho de l’histoire, rien n’égale la force évocatrice de l’archive. »
Pour Nicolas, la métaphore est claire :
« Visiter un centre d’archives s’apparente à un voyage dans le temps et dans l’espace.»
Conclusion — Trois voix, une même conviction
Qu’ils soient professeur, jeune archiviste ou réalisatrice, Nicolas, Amaury et Pauline partagent une même certitude : les archives ne sont pas des objets figés, mais des corps vivants de mémoire, capables d’éclairer notre présent et de questionner notre rapport à la société.
Dans leurs mains, le document d’hier devient parole d’aujourd’hui.
Et vous ? Vous êtes utilisateur ou utilisatrice d’archives et souhaitez partager votre « archive coup de cœur » ou votre rapport intime au document ?
Aksoni accueille volontiers vos témoignages.
Vous souhaitez lire les deux autres articles « coups de cœur » ? Ils sont disponibles ici : archives publiques et archives privées.